Le secret du droit naturel ou Après Villey, Pierre-Yves Quiviger, Paris, Classiques Garnier, 2013
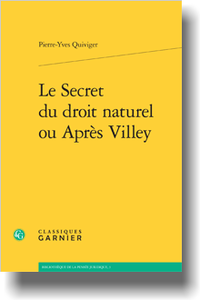
1. L’ouvrage de M. Quiviger s’inscrit nettement dans les sillons tracés par la pensée de Michel Villey, une telle démarche étant revendiquée dès l’introduction. Renvoyant dos à dos les positivistes et les tenants du droit naturel moderne, l’auteur prend le parti de défendre le droit naturel classique, celui d’Aristote. Rappelons que d’après le droit naturel classique, le droit est dans les choses, dépend de l’ordre du cosmos, tandis que pour le droit naturel moderne, le droit naturel est un ensemble de règles éternelles déduites par la raison au regard d’une nature humaine immuable.
2. Ainsi, M. Quiviger fait preuve d’une lucide bienveillance à l’égard de l’œuvre de Villey, estimant que, malgré certaines imperfections historiques, ses travaux demeurent porteurs d’enseignements dans le champ de la philosophie (comp. S. Piron, « Congé à Villey », L’Atelier du Centre de recherches historiques, http://acrh.revues.org/314).
3. Les propos de l’auteur viseront donc à démontrer quatre idées que l’on peut tenter de présenter ainsi :
- rejet du droit naturel moderne : le droit naturel doit s’appuyer sur l’ensemble du monde, non uniquement l’être humain ;
- rejet de la confusion entre le droit naturel et la morale (l’articulation avec la morale étant brièvement exposée p. 20, puis plus longuement p. 142 sq.) ;
- rejet de l’intégration du droit naturel au droit positif sous la forme d’une norme, sans que, pour autant, toute inspiration du droit positif par le droit naturel soit exclue (cf. conclusion, p. 181) ;
- rejet de tout idéalisme : l’auteur revendique un jusnaturalisme qui serait un réalisme dans la mesure où il refuse d’isoler arbitrairement une partie de la réalité.
4. La définition du droit naturel est précisée dans la première partie, les deux autres étant consacrées respectivement à une analyse de la propriété et de l’obligation.
5. La première partie de l’ouvrage, intitulée « Le droit n’est pas la loi », permet à l’auteur de revenir sur le critère du droit, critère qui serait l’intervention du juge, d’un tiers impartial. Nous reconnaissons là, peu ou prou, le critère dit de la justiciabilité, tel qu’il a pu être mis en avant, notamment, mais de manière particulièrement approfondie, par Kojève (Esquisse d’une phénoménologie du droit). L’intervention du juge est finalisée : il s’agit de rendre à chacun le sien.
6. Le chemin qu’emprunte M. Quiviger pour affirmer que le droit est lié à l’intervention du juge suit les traces d’Aristote et passe par l’opposition entre la justice particulière et la justice générale présentée dans l’Éthique à Nicomaque : seule la première, la justice particulière, fait « nécessairement appel à un tiers neutre » (p. 21), la seconde, la justice générale, désignant le portrait moral de l’homme juste, sinon au sens de saint, du moins d’honnête homme.
7. Puis, se concentrant sur la justice particulière, M. Quiviger reprend la distinction artistotélicienne de la justice distributive et de la justice corrective. Considérant ces deux figures de la justice comme des techniques pour parvenir à une fin, il nous livre le secret du droit naturel : « parvenir à l’équilibre, en considérant que cet équilibre est source de paix sociale » (p. 27). La raison d’être d’une décision de justice, la raison d’être du droit, est cet équilibre. La présentation du droit naturel sera étoffée en conclusion de l’ouvrage grâce à la mention, entre autres, d’un autre extrait de l’Éthique à Nicomaque, à savoir le passage où Aristote oppose clairement le juste naturel et le juste conventionnel (Livre V, 1134b18, sur lequel voir le profond article de V. Descombes, « Aristote, la justice naturelle et la justice positive », dans Le raisonnement de l’ours, Seuil, p. 361 sq.).
8. On comprend dès lors que le titre de cette première partie doit être saisi dans son sens le plus complet. D’une part, le droit n’est pas que la loi, d’autre part, toute loi n’est pas du droit.
9. Si la première assertion est aisément acceptable, la sociologie juridique ayant montré que le « droit est plus grand que l’ensemble des sources formelles du droit » (J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, 2 e éd., 2004 [1978], p. 333), la seconde est moins intuitive, tant la loi fait figure de règle juridique par excellence
10. Afin de concrétiser son projet de présentation du droit naturel, l’auteur propose de revenir sur deux notions au cœur du droit, à savoir la propriété et l’obligation, la propriété faisant figure d’une « certaine impasse subjectiviste du droit contemporain » (p. 35) et l’obligation de voie royale pour bâtir une théorie générale du droit.
11. La deuxième partie de l’ouvrage (« La question de la propriété ») vise ainsi à démontrer que la propriété ne concerne pas l’appropriation des choses, mais constitue un lien d’exclusivité entre un point d’imputation – un sujet de droit – et une chose. En d’autres termes, la propriété sert à désigner un lien spécifique entre une chose et un propriétaire. Ainsi, la propriété vise au propre, quand la possession vise à l’appropriation1
12. L’auteur parvient à ce constat en s’interrogeant au préalable sur la notion de propriété, sur ses sens métaphysiques et logiques avant de s’interroger sur son sens juridique.
13. Au terme d’un itinéraire particulièrement riche consacré au concept de propre, celui-ci apparaît comme désignant ce qui est propre à quelqu’un, ce qui permet de dire qu’il s’agit de tel individu et non de tel autre (pour grossir le trait). C’est le caractère distinctif de la propriété qui est ainsi mis en avant.
14. Le concept de propriété est ensuite affiné au regard de la distinction entre la propriété-état (hexis, habitus : on possède ainsi une vertu) et la propriété-possession (ktêsis : on possède ainsi un vêtement). Selon l’auteur, si seule la propriété-état est une propriété distinctive, la distinction hexis/ktêsis doit être pensée au regard d’une autre opposition, celle de l’être et de l’avoir, puisque c’est à partir de ces deux couples, de ces quatre variables, que va pouvoir se poser la question de l’appropriable : l’acquisition de possessions, de choses, ne permet pas d’acquérir plus d’être, de se perfectionner.
15. Or, s’interroger sur l’appropriable c’est ouvrir la porte au mouvement qui précède la propriété, à savoir l’appropriation. L’auteur rappelle ici que selon Locke, le besoin d’appropriation découle du désir de domination : l’exemple est celui de l’enfant qui cherche à prendre au-delà de son besoin, le rôle de l’éducateur étant alors de porter une limite au désir, la limite du besoin.
16. Le thème de l’appropriation est important car il invite à envisager l’approprié, dont la polysémie est extrêmement riche. L’approprié renvoie ainsi tant à la possession qu’à la parenté, à la complémentarité et à ce qui est adapté. La pointe de la démonstration peut alors surgir : l’appropriation permet la distinction. Pour reprendre les termes de l’auteur : « on peut alors comprendre la notion de propriété, comme propre-ité, comme le fait de s’approprier le propre, et en particulier, son propre propre ».
17. La propriété renferme donc en elle ces deux éléments de distinction et de possession.
18. Fort de cet important travail préalable, l’auteur peut alors rechercher ce qu’est la propriété au sens du droit, prenant comme point de départ les articles 544 et 545 du Code civil. Afin de montrer que la propriété juridique est la distinction, et non l’appropriation qui renvoie à la possession, M. Quiviger va se fonder sur différents éléments comme le démembrement de propriété (qui est véritablement propriétaire si ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire n’ont l’abusus ?), l’abus de droit (comment dire qu’une personne n’a pas d’intérêt sérieux dans tel ou tel usage de la chose si on se contente de voir la propriété comme une souveraineté ?) et la distinction du jus et du dominium, le jus étant ce qui m’est propre puisque cela m’a été approprié justement, le dominium étant le pouvoir, la maîtrise de la chose. Le jus relève du droit, c’est la propriété, distinctive, le dominium relève du fait, c’est la possession, l’appropriation.
19. Sont alors proposées des pistes de réflexion au juriste et à l’économiste quant à la question de la propriété ainsi comprise. L’auteur, soulignant la nécessité de prendre en compte la propriété commune à côté de la propriété privée et de la propriété publique, invite à s’interroger, notamment, sur le sort des choses communes (res communes), comme le problème de la pollution de l’air ou du gaspillage des ressources (thèmes envisagés notamment, sauf erreur de notre part, par les économistes via le théorème de Coase<fn>Rappelons, brièvement et à grands traits, que pour pour traiter le problème de la pollution, Coase estime qu’il est préférable de lier droit de propriété et droit de polluer plutôt que de mettre en place un système de taxes (envisagé par Pigou, à travers le principe pollueur/payeur). Ainsi, selon Coase, le droit de propriété d’une ressource donne le droit de polluer. Attribuer clairement un droit de propriété et, partant, un droit de polluer, est nécessaire pour éviter la situation où le pollueur aurait autant le droit de polluer que le pollué le droit de ne pas être pollué. A suivre le système de Coase, si une entreprise a la propriété des ressources, elle a le droit de les polluer. Les pollués devront alors négocier avec elle pour que son comportement change : par exemple offrir une compensation à une baisse d’activité souhaitée. L’intervention de l’État serait alors inutile pour traiter le problème de la pollution, la négociation suffirait.</fn>
20. Ces éléments, ces propositions de réflexion ne sont cependant soumis au lecteur qu’après qu’un détour a été effectué pour cerner la notion d’appropriation et mener une réflexion sur la valeur. La pensée de Locke est à nouveau invoquée pour rappeler qu’une des manières de justifier l’appropriation est le travail. En cela, Locke conduit à Marx et à la valeur travail : ce qui était un critère de propriété pour le premier devient un critère de valeur pour le second. Pourtant, ce que Marx, malgré lui, mettrait réellement en avant, n’est pas le fait que la valeur soit liée au travail, mais à la circulation de la chose. Selon les termes de M. Quiviger, « si la propriété est valeur, si la propriété dégage de la valeur, c’est parce qu’elle est dépassement (par le droit, par l’économie) de l’être-là, de la chose : elle fait de la chose “matière à dépense”, et la quête d’une valeur intégrée objectivement à la chose par le travail est économiquement peu heuristique (même si elle est politiquement utilisable) » (p. 115).
21. Pour parfaire sa démonstration, c’est enfin à Nozick que M. Quiviger va recourir afin de montrer que l’appropriation ne peut pas être justifiée en droit, ne peut pas être justifiée rationnellement. En ce sens, M. Quiviger rejoint les affirmations de Villey pour lequel « on ne gaspillera pas sa peine à découvrir de prétendus titres “originaires” de propriété : “l’occupation”, avec le mythe du consentement universel au droit du premier occupant (GROTIUS) – ou le “travail” (LOCKE). Jamais le rationalisme moderne n’est parvenu à expliquer le partage des propriétés » (Philosophie du droit, Dalloz, 2001 [1984-1986], p. 264).
22. La conclusion de l’auteur est la suivante : « la leçon du “droit naturel” est donc qu’il convient de laisser au second plan une enquête portant sur la nature du pouvoir que le propriétaire a sur sa chose au bénéfice d’une description, la plus fine et exhaustive possible, de la connexion logique et métaphysique qu’on peut établir entre un point d’imputation juridique (un sujet, une personne) et une chose » (p. 123).
23. Le propos rejoint ainsi, nous semble-t-il, un des courants de pensée actuels en droit civil visant à redéfinir la notion de propriété à partir de l’exclusivité – cf. not. F. Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ. 1993, p. 305 sq. Comp. W. Dross, Droit civil. Les choses, LGDJ, n° 42-1, p. 85, qui rappelle que selon Durkheim, « le droit de propriété consiste essentiellement dans le droit de retirer une chose de l’usage commun. (…) Le droit de propriété se définit beaucoup plus par un côté négatif que par un contenu positif, par les exclusives qu’il implique que par les attributions qu’il confère » (Leçons de sociologie, PUF, 2010, p. 171-172).
24. On peut se demander si, au-delà du recours à la distinction opérée par le droit entre la propriété et la possession<fn>Remarque : la distinction entre les actions possessoires et les actions pétitoires, opportunément mentionnée à la la note 3, p. 84, relève désormais de l’histoire du droit, l’article 9 de la Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ayant abrogé l’article 2279 du code civil, siège de l’action possessoire.fn</fn> l’auteur n’aurait pas pu interroger la notion de bien, telle que les juristes la comprennent. En effet, les thèmes de l’appropriation et de la valeur paraissent renvoyer avant tout à la question de la qualification d’une chose comme bien, de même que les doutes relatifs au caractère appropriable d’une chose ne relèvent pas que de la possession mais de la conception qu’on peut se faire de la notion de bien. Ainsi, la question de la libre disposition du corps humain et de ses éléments, question loin d’être neutre économiquement et axiologiquement, paraît se poser avant tout en termes de « bien » plutôt que de « possession »<fn>Sur la notion de bien, cf. not. P. Berlioz, La notion de bien, LGDJ, 2007.</fn>
25. Toujours est-il que l’idée de point d’imputabilité, de lien, invoquée pour parler de la propriété, fait également l’objet des développements de la troisième partie de l’ouvrage consacrée à l’obligation juridique. La propriété mène ainsi à l’obligation.
26. La thèse qu’entend défendre l’auteur ici est que le lieu juridique de l’obligation est la relation complexe existant entre le créancier et le débiteur, ce que l’auteur qualifie de nexalité, « terme forgé à partir du terme nexus qui désigne le nœud complexe unissant le créancier et le débiteur », préférable selon lui à la formule « lien de droit », trop peu précise pour rendre compte de la nature du rapport juridique existant entre le créancier et le débiteur.
27. Pour parvenir à cette conclusion, M. Quiviger dépouille l’obligation juridique de tous ses faux attributs. Pour ce faire, l’auteur revient sur la distinction du droit et de la morale pour constater que le droit, s’il est un énoncé performatif, ne trouve sa réalisation que grâce à l’ensemble de la collectivité. La collectivité est alors regardée à travers le prisme de la fraternité, dont l’expression la plus exacte juridiquement serait celle de la solidarité.
28. Or, la solidarité invite à penser autrement l’opposition entre l’obligation morale et l’obligation juridique à travers le droit-créance, qui met lui-même en évidence toute la pertinence de l’obligation naturelle. La conclusion s’impose alors : si l’obligation naturelle est juridique, si l’obligation naturelle est tout aussi juridique que l’obligation civile c’est que l’essentiel du rapport juridique se situe dans l’engagement du débiteur, le debitum en latin, la Schuld en allemand, et non dans le pouvoir de contrainte du créancier, l’obligatio, la Haftung, dont est dénuée l’obligation naturelle.
29. Cette mise à nu de l’obligation permet de reconsidérer les droits de l’homme ou les droits fondamentaux en invitant à rechercher ce qu’il y aurait en eux de juridique (l’État peut en être le débiteur), et à atténuer la critique de Villey portant sur leur ineffectivité, dès lors que celle-ci ne relève aucunement de l’essence de l’obligation. De même, une telle conception de l’obligation, comme nexalité, permet de penser ensemble le délit et le contrat, le droit pénal et le droit civil.
30. En conclusion, l’auteur revient sur ce qu’est le droit naturel, en montrant le caractère excessif de la distinction du fait et de la valeur, lesquels n’ont pas d’existence en soit, mais ne sont que des aspects de la même réalité (sur cet point, nous ne pouvons que recommander l’article de Ph. I. André-Vincent, « L’abstrait et le concret dans l’interprétation », Arch. Philo. Dr, t. 17, p. 135 sq.).
31. Cette précision montre combien il est important de partir de l’être et de se poser la question de la langue du droit : indicatif plutôt qu’impératif, puisque le droit « se contente de dire » (p. 175).
32. La réflexion de l’auteur sur le juste naturel le conduit alors à examiner les caractères du droit naturel. Mobilité et diversité du droit naturel sont ainsi expliquées, afin d’écarter la tentation d’un droit naturel fixe (cf. le droit naturel moderne) mais également la tentation d’un droit comme pure contingence, comme purement factice, et dont on ne pourrait alors rien dire. Deux tentations auquel succombe le positivisme rationaliste.
33. In fine, après une brève réflexion sur le rôle de la jurisprudence par rapport à celui de la loi, passant ainsi naturellement de la vertu de justice à celle de la prudence, l’auteur termine en présentant les caractéristiques du bon juge, cheville ouvrière du droit naturel.
34. Notre conclusion sera quant à elle la suivante : la lucide bienveillance de M. Quiviger à l’égard de la pensée de Villey fait de son ouvrage un outil efficace de défense du droit naturel mais, également, un support stimulant et fécond pour aborder sous un angle renouvelé les concepts juridiques de propriété et d’obligation.
Note
- P. 123 : « Si l’on veut construire une théorie générale de la propriété, qui ne néglige aucun des visages que le droit en connaît, il faut l’inscrire dans le concept du propre comme lien spécifique, qui ne signifie ni un pouvoir particulier sur la chose, ni ne consacre l’impossibilité de plusieurs liens spécifiques de nature différente entretenus par la chose avec des propriétaires distincts. Le lien de propriété est avant tout un lien de désignation, il permet de donner le nom de celui est en mesure d’accomplir, conformément au droit, un certain nombre d’actions. » ↩︎