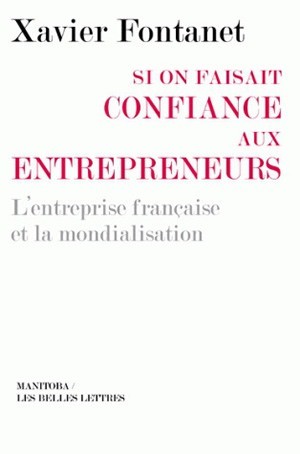
Xavier Fontanet, Si on faisait confiance aux entrepreneurs : l’entreprise française et la mondialisation (Manitoba/Les Belles Lettres, 2010)
1. La figure de l’entrepreneur parcourt la théorie économique depuis le xviii e siècle. C’est au banquier français Richard Cantillon (1680-1734) que l’on doit la première esquisse de ce qui caractérise la personne de l’entrepreneur : dans son Essai sur la nature du commerce en général (1755), Cantillon présente l’entrepreneur comme quelqu’un possédant une aptitude à affronter l’incertain, et le distingue en cela des propriétaires et des fermiers qui vivent de rentes, c’est-à-dire de rémunérations sans incertitude. Cette spécificité disparaîtra progressivement dans la pensée économique ultérieure. Adam Smith (1723-1790) dépersonnalise l’entrepreneur avec la main invisible. David Ricardo (1772-1823) le réduit à un capitaliste (l’entrepreneur est celui qui détient le capital). Jean-Baptiste Say (1767-1832) en fait un organisateur répartiteur de risque en avenir certain. John Stuart Mill (1806-1873) le voit comme une sorte d’intermédiaire obligé entre production et consommation. Alfred Marshall (1842-1924) l’assimile à un manager. La disparition de l’entrepreneur est confirmée dans la pensée microéconomique classique. Chez Léon Walras (1834-1910), l’entrepreneur est confiné à la fonction de production. Chez Vilfredo Pareto (1848-1923), l’entrepreneur devient l’agent de liaison entre les produits et les marchés. La pensée économique néoclassique achève de faire disparaître la personne de l’entrepreneur avec deux postulats qui rendent inutile sa présence : la transparence du marché (symétrie dans l’information) et l’homogénéité des produits (substituabilité des biens et différenciation par les seuls prix). Au vingtième siècle, John Kenneth Galbraith (1908-2006) considère que l’individu entrepreneur doit être remplacé par des organisations collectives. Enfin, la théorie financière de l’efficacité informationnelle des marchés d’Eugene Fama (1939-) ignore simplement l’entrepreneur, qui a pour principal défaut d’invalider les hypothèses néoclassiques sur lesquelles se fonde cette théorie. La pensée néoclassique définit le risque comme de l’incertitude mesurable, et ne peut modéliser les situations d’incertitude dans lesquelles les statistiques et les lois des grands nombres ne fonctionnent pas. Justement les situations auxquelles l’entrepreneur est confronté.
2. On comprend dès lors la démarche à l’origine de l’ouvrage de Xavier Fontanet, ancien président d’Essilor, Si on faisait confiance aux entrepreneurs. L’entreprise française et la mondialisation (2010) : faire émerger la figure de l’entrepreneur en en montrant son importance pour l’économie française aujourd’hui, en s’appuyant sur son expérience de PDG d’une entreprise qu’il a fait entrer dans le CAC40. Par rapport aux témoignages d’autres présidents de sociétés du CAC40, nommés alors que la société figurait déjà dans les quarante capitalisations boursières les plus importantes de la cote française, Xavier Fontanet a porté Essilor à l’intérieur du CAC40 alors qu’au départ, cette société en était loin. Cette aventure industrielle constitue la première partie du livre et représente, pour son auteur, la légitimité professionnelle qu’il revendique pour présenter ensuite sa conception de l’entrepreneur. En cela, Fontanet rejoint une tradition solidement établie de professionnels (chefs d’entreprise, hauts fonctionnaires) qui sont intervenus de manière féconde dans les débats économiques universitaires en sachant transformer leur expérience de terrain en réflexion destinée à suggérer que d’autres voies de la pensée économique étaient possibles.
3. Parmi ses prédécesseurs, on trouve trois personnalités emblématiques qui, comme lui, cherchent à pointer les défaillances de la pensée néoclassique universitaire. Aux États-Unis, le chef d’entreprise Frederick Hawley (1843-1929) qui dirigeait une société de bois de charpente, s’opposa aux thèses de l’économiste autrichien Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914) en contestant les raisons que donnaient Böhm-Bawerk pour expliquer le profit des entreprises. Il déclencha une vive polémique entre 1891 et 1904 dans la célèbre revue Quarterly Journal of Economics. Alors que Böhm-Bawerk justifiait le profit par la rémunération de l’apport du capital et du travail fourni, Hawley montra qu’il manquait dans cette analyse un élément important, la rémunération de l’engagement dans l’inconnu, engagement qu’il expérimentait dans sa pratique d’entrepreneur. En France, le haut fonctionnaire Gaston Berger (1896-1960) critiqua le positivisme de la science économique d’alors, marquée par le scientisme. Alors que les méthodes de prévision économique restaient linéaires (relation hiérarchique simple entre cause et effets), Berger montra que les recherches de régularités statistiques passées sont insuffisantes car elles se heurtent à la complexité du monde économique, complexité qui casse la relation hiérarchique simple entre cause et effets (existence de non linéarités). Il forgea dans ce but la notion (et le mot) de « prospective » en insistant sur le fait qu’il est facile de répéter, moins facile d’entreprendre. Pierre Massé (1898-1987), commissaire au Plan puis président d’EDF, intervint à plusieurs reprises dans les débats économiques en attirant l’attention sur les embarras produits par l’excès de données dans les prises de décision sur l’avenir. Plutôt que de chercher une prévisibilité dans le traitement massif de données, Massé mit en évidence l’importance de la stratégie active face à l’inconnu. Pour l’action, le probable n’est qu’un canton du possible, dira Massé, pour qui une incertitude profonde affecte les prévisions les plus fines. Le point commun qui réunit ces trois interventions de professionnels non universitaires est une intention identique : attirer l’attention des économistes universitaires sur une dimension centrale non prise en compte dans la pensée économique néoclassique, le rapport à l’incertitude de l’inconnu, un inconnu non réductible à des calculs classiques de risque qui utilisent les statistiques et les probabilités. C’est à cette question cruciale que Xavier Fontanet consacre la troisième partie de son ouvrage.
4. Pour rendre raison de son expérience professionnelle, Fontanet va mobiliser un autre courant de la pensée économique que la théorie néoclassique, l’école autrichienne, qu’il va compléter avec les méthodes pratiques développées par une personnalité hors du commun qu’il a rencontrée par hasard à Paris au début des années 1970 – dont le lecteur devine qu’elle l’a profondément marqué (il en parle comme d’une « légende vivante ») –, le fondateur du Boston Consulting Group (BCG), Bruce Henderson. La raison du choix de l’école autrichienne est simple. Contrairement à la pensée néoclassique, l’école autrichienne a abordé le problème de l’incertitude radicale de l’inconnu du futur. Karl Popper (1902-1994) a montré l’impossibilité absolue de prévoir les connaissances futures, d’où il en résulte que l’inconnu technique est un inconnu radical pour l’entrepreneur. Joseph Schumpeter (1883-1950) fait de ce progrès technique imprévisible le moteur de l’économie, d’où il en résulte un processus de destruction / création sans fin d’activité nouvelles. Par exemple, l’apparition du téléphone portable bouleverse les équilibres des télécommunications, celle de la photographie numérique a pour effet la disparition des fabricants d’appareils photo argentiques les plus solidement établis. Friedrich Hayek (1899-1992) a montré les limites de nos connaissances face à la complexité et l’incomplétude intrinsèque de tout calcul économique. L’interaction des agents entre eux est une source d’incertitude. D’où il en résulte que l’inconnu de la concurrence est un inconnu radical pour l’entrepreneur. L’entrepreneur s’engage dans l’incertain alors que le marché pour ses futurs produits n’existe pas encore. Il n’a pas d’idée précise sur ce que sera l’état du monde au moment où ses produits seront prêts, et doit, en quelque sorte « créer » le marché.
5. À ce stade de la lecture, il apparaît un grand absent qui pourtant serait très utile pour étayer ces propos, l’économiste américain Frank Knight (1885-1972) qui, dans son maître ouvrage Risque, incertitude et profit publié en 1921, a introduit une distinction canonique entre risque et incertitude. Cette distinction permet de relire Fontanet en réorganisant ses réflexions autour de la notion d’incertitude knightienne. Pour Knight, l’incertitude est, soit mesurable par le calcul des probabilités ou les statistiques, soit non. Knight propose de conserver la notion d’incertitude aux situations d’incertain non mesurable et d’appeler « risque » les cas où l’incertitude est mesurable. Ce sont les cas traités par la pensée néoclassique qui ne distingue pas les notions de risque et d’incertitude, et c’est l’une des raisons pour lesquelles l’entrepreneur n’a pas de place dans la pensée néoclassique. Pour Knight, la justification du profit des entrepreneurs n’est pas à chercher dans la rémunération de la prise de risque (mesurable) mais dans un engagement hardi dans l’incertitude (non mesurable) en prenant des risques que ne voudraient pas supporter les autres. La rémunération des entrepreneurs payerait donc quelque chose qui n’est pas contenu dans l’apport en capital des actionnaires et le travail des salariés : l’affrontement des entrepreneurs au danger, qui serait leur travail propre, leur marque (de fabrique) propre. Les entrepreneurs ne sont, de ce point de vue, ni des capitalistes, ni des managers. Le « vrai » entrepreneur travaille dans l’incertain et, dans ce sens, Knight rejoint l’intuition de Cantillon. C’est exactement ce que veut dire Fontanet, et nous pensons que le fondement théorique de ce qu’il cherche à mettre en évidence – dans sa défense des entrepreneurs – est donné par le cadre conceptuel de l’incertitude radicale chez Knight.
6. Pour naviguer dans cet inconnu radical, il faut des outils méthodologiques. C’est là que, pour Fontanet, apparaît l’apport de Bruce Henderson. Cette alliance entre une théorie économique hétérodoxe et des méthodes pratiques de stratégie constitue le socle intellectuel de l’approche de Fontanet et illustre ici encore la différence entre son approche et une perspective purement universitaire. Les impasses de la pensée néoclassique et les débats des années 1930 autour de l’école autrichienne font désormais partie du bagage des économistes universitaires (il existe toute une tradition de recherche que la synthèse néoclassique ne satisfait pas), tandis que les méthodes de stratégie du BCG continuent à faire partie de la boîte à outils des consultants du monde entier. Mais l’articulation entre les deux, consistant à proposer l’utilisation des méthodes de Bruce Henderson pour compenser par la stratégie les limites de la connaissance et la surprise des inconnus techniques, est nouvelle et représente ici la trace personnelle de l’auteur.
7. Bruce Henderson (1915-1992) est une personnalité hors du commun dans le monde professionnel américain. Au moment de sa mort, le Financial Times titra : « peu de personnes ont eu un impact aussi important sur le monde des affaires internationales dans la seconde moitié du vingtième siècle que le fondateur du Boston Consulting Group ». Sa très grande reconnaissance professionnelle alla de pair avec une faible reconnaissance universitaire. Il y a deux raisons à cela. La première était qu’il ne publiait pas ses travaux dans des revues universitaires mais dans les publications internes du BCG ou des revues professionnelles comme la Harvard Business Review. Une autre raison plus déterminante résulta d’un changement d’attitude des universitaires avec la critique épistémologique engagée dans les années 1980 contre les outils du BCG, en particulier la courbe d’expérience et les matrices stratégiques. Ces notions furent extrêmement discutées par la communauté universitaire qui, après les avoir acceptées avec enthousiasme dans les années 1970, en montra plusieurs limites importantes dans les années 1990. Nonobstant ces limites, dans les années 2000, Henderson fut réhabilité : en 2002, ce fut le premier non universitaire à recevoir – à titre posthume – un prix (la médaille d’argent) de la Strategic Management Society. Depuis, il est reconnu comme l’inventeur du métier de conseil en stratégie et de la pensée stratégique du management.
8. Les deuxième et quatrième parties de l’ouvrage abordent la question de la morale et des excès de la financiarisation de l’économie (négation du temps et attirance pour le « courtermisme »). Par rapport aux autres parties, très stimulantes et suggestives, ces deux parties apparaissent moins convaincantes. L’auteur ne capitalise pas sur son intuition fine de la spécificité de l’entrepreneur (affronter l’incertitude) et va chercher ailleurs une pensée qui ne permet pas de déployer une réflexion éthique à partir de cette spécificité. Utilisant l’ouvrage d’André Comte-Sponville Le capitalisme est-il moral ? (2004), Fontanet considère que l’économie de marché est a-morale dans le sens où son essence ne relève pas d’un questionnement éthique mais d’un fonctionnement technique. Le passage de l’ouvrage de Comte-Sponville qui fixe cette représentation est explicite : « prétendre que le capitalisme est moral, ou même vouloir qu’il le soit, ce serait prétendre que l’ordre technoscientifique est intrinsèquement soumis à l’ordre de la morale, ce qui [est] exclu par leur type respectif de structuration interne » : on se trouve ici devant une « distinction des ordres » au sens pascalien. Amoral revient à dire que l’économie de marché de la pensée néoclassique – dans le sens des mécanismes de l’échange qui la constituent – est axiologiquement neutre (n’est pas porteuse de valeurs morales). Cette façon de voir rejoint celle d’une pensée sociale chrétienne actuelle pour laquelle le marché ne représente que le « comment » de l’échange, les valeurs morales ou religieuses constituant le « pourquoi » du partage. C’est la variante éthique de la classique répartition des domaines de compétence entre science et foi selon laquelle la science s’occuperait du « comment » et la foi du « pourquoi ».
9. Le problème posé par cette division des compétences entre technique et morale vient de ce qu’à aucun moment n’est posée la question du contenu moral de la technique. On ne se demande pas si la théorie néoclassique n’est pas elle aussi porteuse de valeurs morales qu’elle tendrait à imposer sous couvert d’une neutralité axiologique revendiquée de la part les techniciens de l’économie de marché. La division du travail (un outil technique amoral et des acteurs moraux) restreint la morale au comportement individuel sans considérer l’influence des structures du système (règles, normes, conventions, outils techniques) dans lequel est pris l’individu qui doit décider. Pour le dire autrement, considérer que les structures techniques sont éthiquement neutres revient à réduire la morale à la déontologie. La vertu des acteurs suffirait à bien orienter le système car l’acteur moralement vertueux ferait fonctionner vertueusement une machine technique économique axiologiquement neutre. La conséquence de cette division des compétences entre technique et morale est donc le report de la charge morale sur l’individu au moyen de l’argument kantien que mobilise Fontanet : traiter les autres comme on voudrait être traité soi-même et agir en se demandant si ce que l’on fait pourrait devenir une loi universelle. Dans ce cadre éthique, il revient aux utilisateurs des outils techniques de gestion de les utiliser dans le sens du bien moral, à défaut de quoi les (mauvais) utilisateurs seront responsables du mal moral (« science sans conscience n’est que ruine de l’âme »).
10. Dans le domaine de l’économie et de la gestion, cette approche est difficilement tenable. Il est maintenant établi que les outils techniques orientent les décisions, que les règles professionnelles conduisent les acteurs à jouer certains jeux (certains « rôles »), que les normes professionnelles ou réglementaires ont pour effet de renforcer telle activité au détriment de telle autre, que les conventions déterminent des marges de manœuvre à l’extérieur desquelles il n’est pas possible d’aller. Par exemple, l’existence de normes professionnelles ou techniques acceptées par tous ou imposées par le régulateur peut entrer en conflit avec la volonté individuelle de régler sa conduite sur ses valeurs propres ou ses raisons cognitives personnelles. On peut être ainsi amené à accepter de manière institutionnelle des propositions qui paraissent fausses à son jugement personnel. De la même manière, des instruments techniques peuvent embarquer ceux qui les utilisent dans des directions non souhaitées. Des conventions de quantification (calculs de risque) peuvent définir des champs d’action restreints. Utiliser un instrument technique ou valider une norme professionnelle font surgir au moins deux questions : les hypothèses à l’origine de cet instrument ou de cette norme sont-elles pertinentes (aspect cognitif du problème) ? Est-il raisonnable de les accepter (aspect sociologique du problème) ? En réalité, la position de Comte-Sponville telle que la mentionne Fontanet revient à penser la morale de l’économie à l’intérieur d’un cadre positiviste : la technique de l’économie est éthiquement neutre. Ceci n’est pas vérifié : les structures techniques de l’économie sont aussi porteuses de valeurs, de même que les modèles mathématiques ou la technologie. L’approche morale par la division des compétences (la distinction des ordres) butte sur le problème de la performativité des modèles techniques, économiques ou financiers : leur façon de structurer les pratiques professionnelles. Même si l’on est vertueux au sens où Fontanet le dit, l’utilisation d’un outil de calcul comme une valeur actuelle détermine des mises en forme du « vrai » monde économique, quand bien même la vertu ferait choisir un taux d’actualisation « juste ».
11. La limite de cette approche apparaît dans la critique de ce que l’auteur nomme « la finance folle ». On ne peut que rejoindre Fontanet lorsqu’il promeut la démarche kantienne, mais en ajoutant aussitôt que, dans cette action, entre aussi l’équipement de celui qui agit. Pour utiliser une métaphore, le skieur a-t-il pris les bons skis pour descendre dans l’inconnu de la neige poudreuse dans un itinéraire de montagne, ou bien s’est-il contenté de s’aventurer en montagne avec des skis de pistes faciles ? Si un accident survient faute d’un matériel adapté, qui est responsable ? Le skieur a-t-il eu le choix de son équipement ? Quittons la métaphore. Dans le domaine financier, l’équipement est souvent imposé : ce sont, par exemple, les progiciels de gestion qui reposent sur des conventions universitaires ou, dans le cas de la finance, des modèles mathématiques. Les analyses les plus récentes de la crise financière montrent comment les outils techniques utilisés, construits sur une pensée économique néoclassique, ont conduit à la catastrophe les institutions et les entreprises qui les utilisaient. La « finance folle » que dénonce Xavier Fontanet est une finance construite sur des modélisations mathématiques qui ignorent le temps et le risque. Il était donc logique que les outils de gestion construits avec ces conventions dangereuses donnent à leurs utilisateurs l’illusion d’une fausse sécurité et les incitent à prendre des positions exagérées. Quand il n’y a aucun risque et des gains espérés élevés, pourquoi faudrait-il ne pas prendre ces positions financières, dans l’optique (justement) d’augmenter les pensions des retraites, selon l’exemple donné par Fontanet lorsqu’il justifie les investissements qui rapportent ? Les décisions des acteurs ont ici été aveuglées par des outils fallacieux, et, comme le dit l’auteur, à la fin de l’histoire, le temps s’est vengé de ce que l’on voulait ignorer qu’il existait, dans les modélisations mathématiques du risque de la théorie financière orthodoxe qui repose sur la pensée néoclassique. Une fois encore, on observe que l’entrepreneur est absent de cette théorisation.
12. Xavier Fontanet appelle de ses vœux une nouvelle forme de pensée économique. Il serait logique qu’une nouvelle forme de morale soit associée à cette nouvelle pensée. En s’appuyant sur les première et troisième parties du livre, on peut en dessiner les grands traits, dans l’attente d’un programme de travail qui en préciserait les contours nouveaux. Le fondement de cette nouvelle approche est donné par le thème que l’auteur aborde tout au long de son ouvrage : le problème de l’incertitude radicale pour l’entrepreneur. C’est la réintroduction de l’incertitude radicale qui permet de se saisir à nouveau du grand absent de la pensée néoclassique : le temps.
13. À ce stade de la lecture, on peut réintroduire un autre grand économiste quasiment absent de l’ouvrage de Fontanet, qu’il mentionne cependant mais pour critiquer l’approche interventionniste qui a été faite de ses travaux, John Maynard Keynes (1883-1946). Pourtant les intuitions de Keynes sur l’incertitude radicale rejoignent les réflexions de Knight. Mais il s’agit d’une lecture hétérodoxe de Keynes, telle qu’elle existe dans, par exemple, l’école française de la régulation et des conventions. Dès 1921 (la même année que Knight) puis en 1937, Keynes insista sur l’impossibilité de réduire l’incertitude radicale par le calcul et, de ce point de vue, de manière surprenante, Keynes rejoint Hayek sur cette question. La convergence entre Hayek, Keynes et Knight sur l’importance de l’incertitude radicale permet de trouver un solide fondement intellectuel pour contrer la pensée économique néoclassique à partir de son point d’achoppement fondamental : le problème de l’incertitude. D’ailleurs Fontanet retrouve – sans le savoir – l’approche keynésienne dans la quatrième partie de son livre. À propos de la politique d’investissement à adopter dans la perspective du long terme, Fontanet prend position contre la diversification maximale (issue de la pensée néoclassique) pour proposer une diversification moindre accompagnée par la connaissance précise des sociétés sur lesquelles on investit. Cette démarche est exactement celle préconisée par Keynes qui qualifiait la diversification maximale de parodie de politique d’investissement. Face à l’incertitude, il est nécessaire de ne pas diversifier en aveugle.
14. En conclusion, ce livre est une lecture stimulante qui appelle des prolongements plus précis, en particulier pour l’éthique de l’entreprise. Nous pensons que c’est la question de l’incertitude radicale – celle à laquelle est confrontée l’entrepreneur – qui permettrait de tracer un programme de travail à composantes multiples. D’une part, la notion d’incertitude délimite la frontière entre une approche « classique » de l’économie (dans laquelle l’entrepreneur ne trouve pas réellement sa place) et une nouvelle approche à laquelle appelle Fontanet au début de la troisième partie. D’autre part, cette notion permet de retrouver les débats refoulés des années 1930 et l’inspiration des travaux de l’école autrichienne. Troisièmement, cette distinction permet de reconsidérer les politiques de placement à long terme selon les vœux de Fontanet, en quittant la diversification maximale de la pensée néoclassique. Quatrièmement, l’introduction de l’incertitude autorise le retour du temps de l’économie, après sa disparition dans l’équilibre néoclassique. C’est à partir de cette notion que pourraient être complétés – en éthique de l’entreprise – les travaux déjà existants sur la responsabilité sociale des entreprises.
Bibliographie
- Campagnolo, G. 2004. Critique de l’économie politique classique : Marx, Menger et l’École historique, Paris : P.U.F.
- Campagnolo, G. et Ch.Vivel. 2014. « Introduction », Revue de philosophie économique, 15/1, p. 3-16. URL : www.cairn.info/revue-de-philosophie-economique-2014-1-page-3.htm.
- Chiapello, E. et P. Gilbert. 2013. Sociologie des outils de gestion. Introduction à l’analyse sociale de l’instrumentation en gestion. Paris : La Découverte.
- Cot, A.-L. et J. Lallement. 2006. « 1859-1959 : de Walras à Debreu, un siècle d’équilibre général », Revue économique, 57/3, p. 377-388. URL : www.cairn.info/revue-economique-2006-3-page-377.htm
- de Bruin, B. 2015, Ethics and the Global Financial Crisis : Why Incompetence is Worse than Greed. Cambridge : Cambridge University Press.
- Fayolle, A. et A. TounÈs. 2006. « L’odyssée d’un concept et les multiples figures de l’entrepreneur », La Revue des Sciences de Gestion, 220-221, p. 17-30. URL : www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2006-4-page-17.htm
- En ligneLe Roy, F. et E. Pellegrin. 2005, « Bruce Henderson comme fondateur de la pensée stratégique », Revue Française de Gestion, 154, p. 9-20. URL : www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2005-1-page-9.htm
- Picavet, E. 2009, « Sur l’acceptation institutionnelle des propositions qui paraissent fausses », in Christiane Chauviré, Albert Ogien & Louis Quéré (éd.), Dynamiques de l’erreur, EHESS, 19, p. 309-334.
- Revue de philosophie économique. 2014, 15/1, Figures de l’entrepreneur.
- Ross, S. 2004, Neoclassical Finance. Princeton (New Jersey) : Princeton University Press.
- Sapir, J. 2000, Les Trous noirs de la science économique. Essai sur l’impossibilité de penser le temps et l’argent. Paris : Seuil.
- En ligneWalter, Ch. 2011. « Performation et surveillance du système financier », Revue d’économie financière, 101, p. 105-116.
- Walter, Ch. 2012. « Éthique et finance : le tournant performatif », Transversalités, 124, p. 29-42.