Étienne Helmer, La part du bronze. Platon et l’économie (Paris, Vrin, 2010)
Article
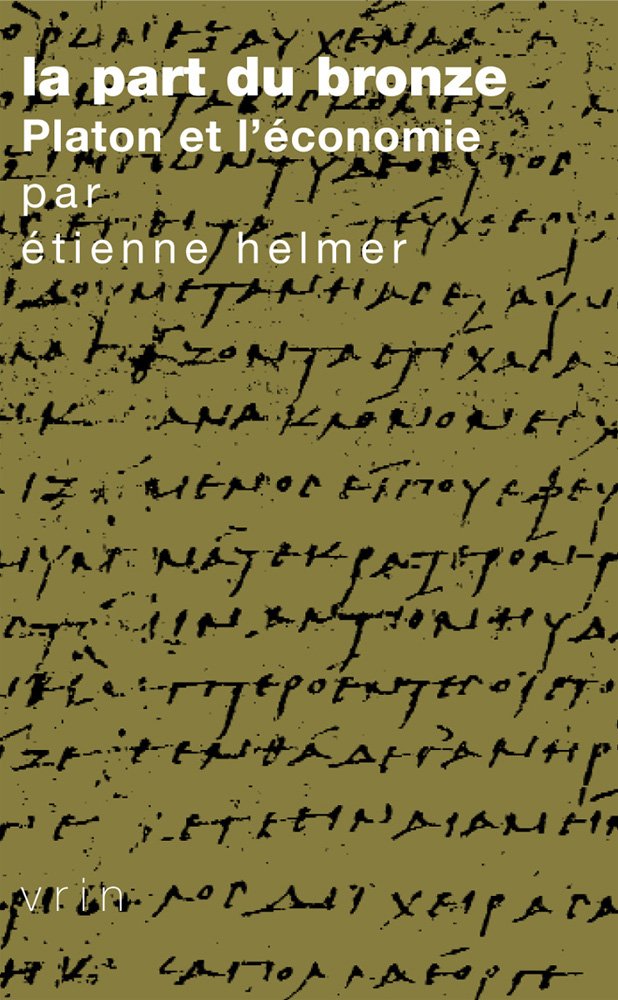
1. Que peuvent nous apprendre les Anciens sur l’économie ? Confinés dans un monde où la cité vit artificiellement des bénéfices de l’esclavage, les penseurs de la Grèce ancienne n’étaient?ils pas bien loin de pouvoir s’imaginer l’autonomie et la rigueur de l’économie politique ? Si, à lire ceux?ci, on rencontrait l’opinion que les mécanismes de l’économie ne sauraient faire l’objet d’une science autonome, parce qu’ils ne constituent pas une réalité propre dont on puisse séparer les raisons de celles qui régissent d’autres champs de la pratique humaine, on aurait tôt fait de voir là le symptôme d’une ignorance des lois qui régissent la sphère des besoins et des activités des communautés humaines. L’un des mérites de l’ouvrage d’Étienne Helmer est d’affirmer qu’une telle vision de l’économie ne résulte pas, chez Platon, d’un tel préjugé, mais s’appuie bien au contraire sur la reconnaissance de la spécificité des phénomènes économiques généraux ; cela permet dès lors à l’auteur de mener son lecteur, avec une grande clarté, à travers l’exploration d’une pensée de l’économie peut-être plus subtile que ce que le lecteur contemporain pourrait s’attendre à trouver chez un penseur du quatrième siècle avant J.-C. Platon reconnaît en effet la spécificité des interactions économiques, qu’il s’agisse de l’activité, de la production, de l’échange, tout en affirmant que cette spécificité n’apparaît qu’une fois subordonnée, tout à la fois par l’anthropologie qui lui offre sa matière et par la forme politique qui distribue au préalable les biens, les hommes et les activités dont elle exprime la circulation. L’économie existe et peut révéler une intelligibilité propre : elle n’est pourtant qu’un effet, celui d’un certain état de l’homme et d’une certaine configuration préalable de répartition des choses, des temps, des espaces et des prérogatives. Voilà, venue d’un lointain passé, une approche intempestive, à l’heure où l’on n’a peut-être jamais autant nourri la représentation – qui n’est peut-être qu’une représentation – d’un ordre économique total, travaillant à produire l’homme et à prescrire à la politique ses raisons. Telle est la question à laquelle la lecture de Platon, aujourd’hui, soumet notre connaissance économique : la reconnaissance de lois propres à l’économie entraîne?t?elle l’autonomie de ce champ de la pratique, soustrait à tout autre principe que les siens propres ? Le déploiement des mécanismes économiques peut?il influer sur d’autres dimensions de l’existence humaine, en modeler la forme et les valeurs ? Un penseur d’un autre temps nous invite à nous demander si nous ne pourrions avoir été victime d’une tendance à accorder trop de réalité à ce dont nous assurons seulement l’intelligibilité. Reconnaître la rationalité de l’économie : et si cela supposait de lui rendre la place qui lui revient dans un ordre des choses où elle n’est ni nécessairement solitaire ni première ?
2. Étienne Helmer propose de présenter au lecteur l’hypothèse que Platon fut l’inventeur de l’économie politique, au sens classique dont l’auteur prend l’exemple chez Rousseau, c’est-à?dire au sens de « sage et légitime gouvernement », non pas « de la maison pour le bien commun de toute la famille », mais « étendu au gouvernement de la grande famille, qui est l’État » (article « Économie Politique » de l’Encyclopédie). C’est bien chez les Grecs que l’on trouve en effet le passage, par analogie, entre l’objet de l’oikonomia, à savoir la gestion des biens, des revenus et des ressources de la maison – l’oikos grec devant être conçu comme une unité élargie, pouvant inclure un domaine, des esclaves, des affiliés –, au souci parallèle, dans le cadre de la cité, de la gestion de ses ressources, de ses biens, de son commerce. Dans ces termes, la proposition de l’auteur de faire de Platon l’inventeur d’une telle extension est peut-être généreuse : il se pourrait que Platon ne soit pas le premier des Grecs à avoir considéré l’administration de la cité par analogie avec celle de la maison. De ce point de vue, l’annexe où l’auteur présente de très utiles synthèses sur les considérations relatives à l’administration des biens et des richesses par la cité que l’on peut trouver chez certains contemporains, ainsi Thucydide, Xénophon et Aristote, ne suffit pas à établir cette primauté : une étude des passages, d’Homère à Hérodote, qui manifestent le souci politique de collecter les ressources (on pense par exemple aux prélèvements sur la production du peuple, dès les poèmes homériques, voir Od. XIX 194-198 ; Il. IX 141-156 ; XII 312-328), d’assurer la production, la récolte ou le commerce, serait alors nécessaire, et certainement féconde. Ce n’était pas, bien entendu, l’objet du présent ouvrage que d’évaluer la place de Platon dans une telle histoire : issu d’une thèse d’histoire de la philosophie et consistant en une monographie consacrée à la pensée platonicienne, l’ouvrage s’en tient pour l’essentiel à une exposition de la réflexion sur l’économie qui peut être extraite de la lecture des dialogues de Platon. Il reste – si une suggestion nous est ici permise – qu’on lirait avec grand intérêt le fruit d’un prolongement de ce travail dans la direction d’une contextualisation de la pensée platonicienne dans une histoire plus vaste de la représentation ancienne de l’économie.
3. Si Platon n’est pas tout à fait le premier, Étienne Helmer peut assurément défendre l’idée que l’Athénien a su tout particulièrement reconnaître la spécificité des mécanismes économiques. L’auteur le fait avec subtilité, en commençant par en dessiner les contours dans le creux de leur absence, au sein du mythe du Politique, avant de les saisir pour eux mêmes au livre II de la République. Dans les deux cas, c’est en effet la même question des besoins, qui, supprimée par l’hypothèse où les hommes, eux-mêmes fruits de la terre, vivent de l’abondance de ce que celle?ci fait spontanément pousser, ou mise en évidence par l’impossibilité où se trouve un individu humain de les satisfaire seul dans leur diversité, fait disparaître ou apparaître une dimension spécifique de l’existence humaine : la nécessité d’une organisation collective de la production. Le récit des origines de la cité, au livre II de la République, est considéré à juste titre par l’auteur comme une expérience de pensée tout à fait exceptionnelle : prenant le contrepied des histoires traditionnelles sur l’origine des cités, qui invoquent le plus souvent leurs héros fondateurs, Platon fait naître la cité de la pure et simple multiplicité des besoins de l’homme, conjoints avec le principe de spécialisation individuelle : c’est parce que les hommes ont naturellement de multiples besoins et ne sont pas naturellement doués pour accomplir toutes les tâches, mais plutôt pour apprendre à en accomplir une de façon satisfaisante – une plutôt qu’une autre, en outre –, que l’association est nécessaire. L’auteur prend soin de distinguer ce principe anthropologique de spécialisation fonctionnelle de celui de la division économique du travail de l’économie moderne : il ne s’agit pas d’optimisation des capacités de production, mais de la limitation des capacités de l’homme (p. 43-49). Le principe lui-même n’est pas économique : on pourrait imaginer que la répartition des dispositions naturelles ne couvre pas tous les besoins (que personne dans une communauté donnée ne soit doué pour le tissage), ou inversement que la floraison des talents déborde les fonctions utiles (si par exemple naissent de nombreux citoyens doués pour monter à cheval dans une cité maritime). Si un individu ne peut être doué dans tous les domaines, s’ensuit?il pour autant que chacun ne puisse accomplir qu’une seule tâche ? Et cela vaut?il de la même façon pour toutes les tâches : n’y a?t?il pas des tâches que davantage sont capables de faire, et d’autres qui ne sont accessibles qu’à peu de gens, après un long et difficile apprentissage (p. 44-45) ? Étienne Helmer souligne à juste titre que ce principe ouvre l’horizon d’une distinction, entre des savoirs absolument non échangeables (ainsi le savoir propre à gouverner la cité, qui ne peut être acquis que par très peu), et ceux qui pourraient l’être : Socrate précise en effet que le charpentier et le cordonnier pourraient bien échanger leurs outils sans causer grand tort à la cité. C’est qu’en dernier instance ce sont moins les métiers que les grandes classes de fonctions dans la cité qui ne sont pas interchangeables : on est naturellement plutôt doué pour exercer une activité « économique » (artisans, agriculteurs, commerçants et hommes d’affaire), ou une activité guerrière, ou une activité délibérative, c’est-à?dire politique (voir p. 46-49). On trouve là la matrice que présuppose l’ordre économique lui-même : la cité ne grandit sous l’effet mécanique de la diversité des besoins que parce qu’elle est d’abord travaillée par un ordre de la répartition des fonctions qui la précède. Il n’y a de l’échange économique que parce qu’il y a une distribution préalable des places dans l’échange. Nous apprendrons à reconnaître là la marque du politique. La tripartition fonctionnelle est fondamentale et elle est celle que Socrate estime nécessaire de sanctifier d’un noble mensonge sur l’origine chtonienne des hommes, façonnés à partir de la terre mêlée d’or, d’argent ou de bronze, et ainsi destinés à diriger, à monter la garde ou à produire (République III 414d-415b). C’est cette part de bronze dans la cité, celle des métiers et des producteurs, qui définit la place de l’économie et donne son titre au livre.
4. En reconnaissant cette double dimension anthropologique et politique du principe de spécialisation, Etienne Helmer n’affaiblit?il pas néanmoins l’idée que Platon, dans ce livre II, fait droit à la dimension autonome du développement économique ? En outre, si Socrate concède le fait que tous les métiers économiques sont relativement interchangeables, ne remet?il pas en cause le fait qu’il y a nécessité d’être plusieurs pour satisfaire aux besoins ? Tout d’abord, n’exagérons pas l’importance de l’interchangeabilité des métiers. Le fait que la nature ne nous destine pas plus à la cordonnerie qu’à la charpente n’empêche pas que le temps d’apprendre ces métiers et d’en accomplir les œuvres nécessitent une spécialisation. Comme l’avait souligné Jacques Rancière dans Le Philosophe et ses pauvres, le temps, autant que la capacité, impose la distribution des tâches – il est ce qui impose encore la distribution des activités, là même où l’hypothèse d’une capacité naturelle spécifique semble faire problème. Le temps révèle un ordre anthropologique des distributions qui précède et permet le dégagement d’une couche économique propre. Cette relative indétermination naturelle des capacités ouvre certes la possibilité, comme le remarque Etienne Helmer, que les individus puissent accomplir une certain nombre de tâches eux-mêmes dans une économie fruste où les besoins sont en nombre limité, en recourant à une division minimale, par exemple sexuelle, des tâches (p. 44). Mais le raffinement et la diversification des besoins auxquelles les hommes semblent spontanément portés finit par réduire cette possibilité d’autarcie. Le temps requis pour bien faire les choses impose la diversité des métiers et la multiplication de la communauté. Cela suffit?il à affirmer cependant l’autonomie d’une dimension économique ? On parvient là à une sorte de paradoxe.
5. Comme le souligne l’auteur, « en plaçant ainsi le besoin à l’origine des rapports sociaux, Platon fait précéder la politique d’un type de rapports avec lequel elle devra composer, et qui semblent rendre légitime l’idée que ce sont les activités et les agents économiques qui font la cité ». Une dimension spécifiquement économique apparaît ainsi indéniablement. Néanmoins, ce plan relevant de l’économie générale, celui de la dynamique propre à la sphère des besoins dans le contexte de la nécessaire spécialisation, est « hétéronome », et cela selon ses « deux bords » (p. 64) : d’un côté le développement des activités et de l’échange est l’effet du développement des besoins qui relèvent d’une sphère purement anthropologique des passions et des désirs, de l’autre, l’économie est soumise à la politique où s’incarne les valeurs qui règlent et dirigent l’activité de la cité. Cette double limite correspond aux « deux thèses fondamentales de Platon sur l’économie » (p. 36-37) : l’institution politique de l’économie et l’assise anthropologique et cosmologique de toute conception de l’économie. La fin du premier chapitre explicite cette deuxième thèse : la sphère des besoins n’est pas autonome dans la mesure où elle ne concerne pas le besoin en général mais celui d’une créature particulière, une partie de la nature dont le corps et l’esprit doivent être situés à leur place dans l’univers. Or, du point de vue corporel comme du point de vue psychique, l’homme est fragile : son corps, à la différence du corps du monde, n’est pas autarcique ; son esprit, à son tour, est vulnérable à l’obsession d’avoir plus, la pleonexia, un terme qui fleurit chez Thucydide et dans la génération de Platon. Bref, la sphère des besoins, avant d’être un champ dont la logique soit autonome, est d’abord l’effet d’un état donné des dispositions humaines. Or cet état s’exprime aussi dans le type de valeurs qu’une communauté d’hommes veut voir régner en son sein. La première de ces deux thèses, celle de l’institution politique de l’économie, est dès lors développée tout au long du deuxième chapitre. Les deux bords de l’économie y semblent se replier l’un sur l’autre : les cités décrites par Platon, tout au long des livres VIII et IX de la République aussi bien que dans le Critias, manifestent la tendance à porter au pouvoir les tendances anthropologiques les plus extrêmes à l’appropriation individuelle. Le fait que de telles cités semblent faire de l’économie une politique ne doit pas nourrir d’illusion sur une prétendue autonomie de l’économie – celle?ci est alors soumise à la libération de certaines tendances anthropologiques à l’appropriation devenues politiquement dominantes. L’absolutisation de l’économie, de ses lois et de son jeu ne sont jamais que des prises en otage de celle?ci par des formes anthropologiques et politiques corrompues. L’économie ne paraît autonome que pour autant que des formes politiques l’instituent dans cette posture, en la soumettant à un ordre dont la finalité n’est plus la satisfaction des besoins mais l’appropriation infinie.
6. La deuxième partie de ce chapitre livre une information importante sur le moment où la poursuite de l’appropriation individuelle en vient à menacer l’existence même de la cité. L’économie, livrée à elle-même par certaines formes de politique, en vient à affecter la matrice de distribution des places et des temps de telle sorte qu’elle remette en cause la possibilité même d’une cité. Il s’agit d’une part de la tendance sociale à « se mêler des affaires de tout le monde », la fameuse polugramosunê, qui s’oppose à l’idéal de « tranquillité » du citoyen, en particulier examiné par L.B. Carter et P. Demont – peut-être Étienne Helmer devrait?il, dans la suite de ses travaux, faire droit à une discussion de ces études importantes –, et d’autre part, de la privatisation de l’espace public, à propos de laquelle l’auteur rapporte d’une manière tout à fait convaincante l’idéal de clôture, d’érection de murs autour de la maison, dont témoignent les cités où l’enrichissement personnel est en cours, à la chambre forte homérique, le thalamos, simultanément lieu de richesse et lieu de pouvoir, soustrait au regard de tous. Le paradoxe mérite en effet d’être souligné : le fait qu’à la manière des sophistes l’activité et les biens circulent librement, le fait que tout le monde touche à tout, quand il veut, où il veut, semble, loin d’y faire obstacle, accompagner et favoriser au contraire le fait que la richesse s’accumule chez les individus, à l’abri des murs de leurs propriétés, et, qu’à mesure que le bien commun se défait, les lieux de pouvoir ne se prêtent plus au regard soucieux de chacun. On pourrait suggérer qu’au contraire, la bonne gestion des besoins humains, c’est-à?dire la bonne économie, telle qu’elle apparaît dans la première cité du livre II, individualise l’activité pour mieux en mettre en commun le fruit.
7. Il revient ainsi à la troisième partie de l’ouvrage d’explorer la façon dont Platon entend rendre l’économie à elle-même, en lui donnant le fondement politique qui lui permette de nourrir une cité stable. Il faut reprendre l’équation de l’échange bien réglé du début du développement du livre II de la République : la distinction des fonctions et l’échange de leurs fruits, par opposition à l’échange des activités corrélé à la privatisation des fruits. Ainsi producteurs et gardiens font?ils chacun ce qu’ils ont à faire, en s’échangeant le fruit de leur labeur, la nourriture et la protection, d’une manière qui exclut la possibilité d’appropriation chez les dirigeants. La politique paraît là encore comme l’instance qui organise la distribution des tâches et les termes de l’échange (voir p. 171). D’une manière assez fine, le rapport de la politique et de l’économie, chez Platon, doit être qualifiée pour ainsi dire comme une relation de dépendance orientée : l’économie a besoin d’une certaine distribution pour ne pas être soumise à des forces qui la rendent corruptrice pour la cité, mais cette politique qui doit lui donner la forme adéquate ne pourrait avoir lieu sans cette organisation de la sphère des besoins. L’économie n’est pas la politique, mais celle?ci n’est pas sans celle?là. Dans la philosophie platonicienne, ce type de rapport peut-être défini comme celui de la « cause auxiliaire » avec la « cause » véritable. Étienne Helmer trouve dans la lecture du Politique l’occasion d’établir ce statut épistémologique de l’économie au sein de la philosophie platonicienne, en passant par une brève mais judicieuse comparaison avec la physique du Timée (184). La sphère des besoins appartient bien à ce type de chose que Platon décrit à la fois comme nécessaires et nécessairement soumises à un autre principe – un matériau, la matériau de l’art politique. On pourrait pousser la comparaison entre les mécanismes économiques et d’autres dont Platon a décrit la prétention à l’autonomie : ainsi les processus physiologiques et mécaniques, examinés dans le Phédon, le Timée ou les Lois, par lesquels ceux qui pratiquent l’enquête sur la nature ont cherché à expliquer toutes choses. Or Platon n’a?t?il pas dans tous ces cas des méthodes similaires pour mettre à l’épreuve la prétention à fonder l’analyse sur ce seul niveau d’explication ? La stratégie consiste en effet le plus souvent à ouvrir un espace théorique où l’on laisse toute latitude à l’expression de ce mécanisme, pour mieux le laisser se rendre de lui-même aux conséquences qu’il ne manque pas de produire dans ces conditions : il révèle ainsi son déficit de causalité et indique par là-même qu’il doit trouver sa place, subordonnée, de causalité auxiliaire au service d’un autre principe. Exactement comme les processus de division ou de composition, en physique, produisent indifféremment l’un comme l’autre de l’unité ou de la dualité (Phédon 96e-97b), le développement porté par la sphère des besoins humains, livré à lui-même, c’est-à?dire au débordement politique de certaines tendances anthropologiques, produit indifféremment de l’ordre ou du désordre politique. Ne nous y trompons pas cependant : subordonner, c’est aussi élire – les mécanismes physiologiques, s’ils doivent être subordonnés à une causalité formelle pour que s’explique ce qui vient à naître sous leur effet, n’en sont pas moins ce sans quoi rien ne naîtrait. Affirmer que l’économie a besoin de la relève de la (bonne) politique, c’est, dans ce schéma platonicien, affirmer aussi qu’elle est l’instrument nécessaire de la politique. La politique doit se saisir de l’économie – elle doit en être l’art d’usage. Ainsi, dans un dernier temps, Etienne Helmer, sous le titre « politiser l’économie », rentre dans le détail des mesures proposées dans la République et dans les Lois pour rendre à l’économie sa fonction de servante fidèle de la cité. Nous savons déjà que pour ce faire elle doit être établie d’une façon qui fait obstacle au déchaînement de l’appropriation privée. La détermination et la limitation des richesses de chacun par attribution de lots de terre, la sortie des femmes hors de la sphère privée de la maison sont de telles mesures, parmi d’autres détaillées dans l’annexe 2.
8. L’ouvrage s’achève sur l’approfondissement du paradoxe qui se trouve en effet au cœur de la politisation platonicienne de l’économie. Le principe de spécialisation fonctionnelle, consistant à s’occuper ses propres affaires, est censé préserver la possibilité d’une chose commune. Comment se fait?il qu’une forme d’individualisation de certaines choses (les activités) soit garantes de la persistance du bien commun, plutôt qu’elle s’avère elle aussi constituer une tendance à la poursuite de l’intérêt personnel ? La limite semble fine en effet entre l’oikeiopragia (faire ce qui nous est propre) vantée dans la République et l’idiopragia (servir son intérêt personnel) condamnée dans les Lois (voir p. 250). Etienne Helmer passe en revue les différentes expressions de ce principe (ta hautou prattein), à travers l’Alcibiade, le Charmide et la République pour suivre comment peu à peu s’en dégage la possibilité d’une finalité non pas individuelle mais collective. C’est dans la République que cette transformation a lieu, une fois la tâche rapportée au naturel de l’individu : chacun doit s’occuper de ce pour quoi il a un talent naturel – faire ses propres affaires ne signifie plus faire pour soi-même mais faire ce que l’on est soi-même le plus apte à faire. L’oikeiopragia est un principe d’adéquation de l’individu et de la tâche (p. 258) et non l’horizon d’appropriation individuel de ces fruits. C’est par ce principe que l’économie devient un élément bâtisseur de la cité. Voilà donc quelle est peut être la véritable originalité de Platon : non pas l’invention de l’économie générale, dont la perspective n’avait peut-être pas échappé à ses prédécesseurs, mais celle d’une politisation de l’économie qui soit en mesure de la rendre à elle-même. Ce n’est en effet que soumise à la bonne distribution des biens, des tâches et des espaces, c’est-à?dire à la politique éclairée, qu’elle peut-être reconnue dans sa spécificité, dans la pureté de règles d’échange dont le libre jeu unit les hommes par la satisfaction de leurs besoins, sans être parasitée par le déferlement des appétits qui la stimulent et des politiques qui la dévoient. Cela suppose encore en retour d’identifier la politique comme l’ordre des distributions des temps et des espaces, des biens et des actes, c’est-à?dire d’identifier la grammaire sensible qui préside à la répartition des différents aspects de la vie humaine en société. C’est à cette grammaire que l’économie doit s’en remettre pour trouver son lieu. Étienne Helmer prolonge ainsi l’intuition de Jacques Rancière dans l’exploration des soubassements sensibles de l’économie platonicienne. C’est en effet un champ prometteur, sur lequel le penseur athénien n’a pas fini de nourrir notre réflexion. Pensez-donc : si, loin d’imaginer que les mécanismes du marché sont aujourd’hui la matrice des lois, des mœurs et des hommes, on se demandait s’ils n’ont fait qu’épouser la configuration que leur imposait une multiplicité de choix préalables quant à ce qui se partage et ce qui ne se partage pas, de nos actes, de nos biens, de nos heures et de nos lieux ?
Bibliographie
- Carter L.B. 1986, The Quiet Athenian, Oxford, Clarendon Press.
- Demont P. 1990, La Cité grecque archaïque et classique et l’idéal de tranquillité, Paris, Les Belles Lettres.
- Rancière J. 1983, Le Philosophe et ses pauvres, Paris, Fayard.